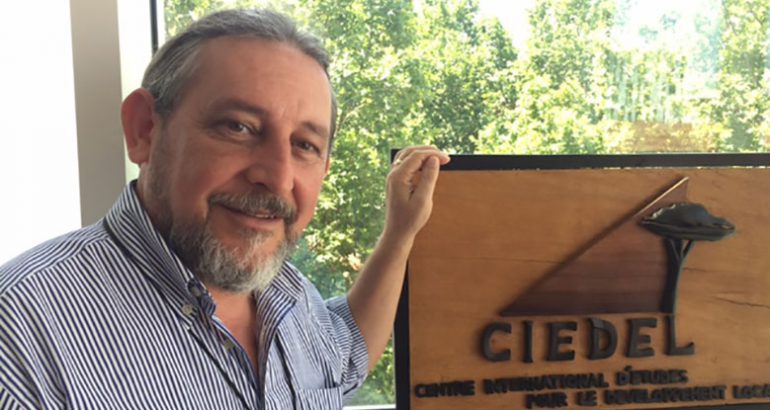
Focus acteur : Carlos Pinto Da Silva, un “prêtre développeur” au Brésil
Carlos Pinto Da Silva est curé au diocèse d’Abaitetuba à côté de Belém dans le delta que forme l’Amazonie au Nord du Brésil. En charge du diocèse, il anime notamment une radio locale et est aumônier de la prison de la commune. Carlos est par ailleurs un ancien élu municipal et continue à s’impliquer dans la vie de la commune dont il est le secrétaire à la santé – à la tête d’un budget qui représente 15% du budget communal. Sur la commune, il a également développé un centre d’accueil pour les personnes dépendantes (drogue, alcool…).
Bonjour Carlos. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail de curé?
La majorité des prêtres « classiques » se focalisent sur le spirituel et la prière. Mais il y en a quelques-uns comme moi qui travaillent sur la société. Au sein de mon diocèse, j’essaie d’organiser une administration plus participative de la paroisse. On a le site central, l’Eglise, duquel dépend une soixantaine de personnes et on fait caisse commune pour mener différents projets. On a créé un conseil pour prendre des décisions, le plus représentatif possible. Chaque communauté religieuse choisit des personnes pour faire partie de ce conseil. On travaille pour former la jeunesse, on fait des choses pour les femmes, les personnes âgées, les enfants… Je suis aussi directeur de la radio créée et soutenue par une fondation de l’Eglise.
En quoi un prêtre peut-il avoir un rôle pour le développement local au Brésil ? Est-ce courant d’être un « prêtre développeur » ?
Ce qu’on fait c’est lier la vie et la foi. La foi permet de projeter les gens. On veut rassembler les gens pour défendre la vie, chercher la justice pour tous, protéger la nature. Nous avons l’idée que les chrétiens doivent participer à la vie politique de leur territoire. Certains prêtres sont dans des associations, des syndicats voire des partis politiques.
Mais l’institution ne porte pas toujours. On n’est pas encouragés à participer à cette vie politique. Normalement quand on est élus, on doit quitter le poste religieux. Personnellement, j’ai eu de la chance : j’ai été élu mais l’évêque m’a permis de rester. Je dois être un des seuls. Pour moi, si des prêtres ont l’envie et la compétence pour contribuer à faire changer les politiques, ils devraient pouvoir. Les prêtres connaissent bien les besoins des gens, ils sont sur le terrain, ils ont la possibilité d’aider.
Un jour, j’espère écrire à propos de mon expérience d’élu. En politique on a parfois une morale qui s’est perdue ; dans le conseil il y a des gens qui représentaient les intérêts d’une communauté ou leurs intérêts personnels avant ceux de la commune, ou qui donnent des pots de vin. En tant que membre de l’Église, on a une certaine autorité morale. Bien utilisée on peut lutter contre la corruption.
Un prêtre qui n’est pas élu peut aussi avoir un rôle. Il participe à la vie sociale. Il peut participer à des audiences, discuter par exemple avec le maire, le juge, les syndicats pour discuter des enjeux de violence. Il faut aussi surveiller que les accords passés par les politiciens puissent aboutir. Quand il y a des accidents industriels, il y a des réunions pour fixer les compensations. L’Eglise peut avoir un rôle pour vérifier qu’elles ont été versées.
Tu travailles sur un territoire agricole, marqué par les tensions. Tu peux nous parler un peu de ce territoire ?
Le Para, c’est deux fois la taille de la France, dans le delta amazonien. Le territoire est découpé entre une forêt au sud, des plaines agricoles qui font du soja, de l’élevage, des biocarburants, et un territoire minier (cuivre, aluminium…). Il y a aussi un port, très important. Du fait de la cohabitation de ces environnements, il y a de gros problèmes environnements et sociaux, avec des pollutions, des déplacements de populations. Il y a pas mal de déforestation pour l’élevage ; les quelques réserves indiennes sont en danger car le gouvernement de Lula n’a pas achevé les lois pour les protéger et en ce moment il y a un gros risque d’exploitation de cette forêt en dépit des réserves.
Globalement, le territoire est très bien pourvu en richesses naturelles. Mais l’état est très grand et la capitale (Belém) regroupe tous les soins, l’université. C’est vraiment centralisé.
Qui sont les acteurs avec qui tu peux travailler sur ton territoire ? Et comment se positionne le diocèse par rapport à tous ces acteurs ?
Le territoire dépend de l’évêque. Certains évêques font un bon travail pour dénoncer l’exploitation de la forêt, traiter du sujet de la drogue, ou encore du trafic de personnes. On peut dénoncer les problèmes auprès du gouvernement, de la presse, de quelques ONG, des Caritas, des syndicats, des organisations de paysans sans terre… Il y aussi quelques députés qui lancent des alertes.
Mais globalement, celui qui a un rôle important c’est le maire. Il est puissant dans une ville comme Belém où il y a une forte activité économique. Evidemment il y a de la corruption. Le peuple reste pauvre. Je dis parfois que Belém est la capitale des inégalités. Dans la région du port, le revenu par habitant est de 10 000€/an, deux fois plus que dans le reste du Brésil et plus que dans la capitale, Brasilia. Or 50% des personnes vivent des aides de l’Etat !
La ville est riche mais n’a qu’une seule école pour les formations techniques. J’ai l’habitude de dire que chez nous, un entrepreneur veut avoir une usine avec un homme et un chien. Un chien pour garder l’usine et un homme pour garder le chien. Evidemment, l’homme n’a pas besoin d’études pour garder le chien. En tant qu’élu, j’ai essayé de mettre en place un second centre de formation technique mais je n’ai pas réussi.
Tu as pourtant monté un centre de formation au Nicaragua. Quand t’es venu ce projet et pourquoi ?
J’ai travaillé 4 ans au Nicaragua avant de venir au CIEDEL. En sortant de la formation en 1999, j’ai dit à mon évêque au Brésil que je voulais retourner au Nicaragua pour faire profiter le territoire de la relecture de mon expérience. Je suis passé aux USA pendant 6 mois pour travailler auprès des migrants, et je suis revenu au Nicaragua. Je me suis dit qu’il fallait que je lance une formation technique pour les jeunes qui n’avaient pas de formation. On était près d’un parc national et on voulait former les jeunes paysans à vivre ensemble sans détruire la forêt qu’ils brûlaient. C’était vraiment étonnant : l’été les gens brûlaient des hectares de forêt pour planter. Les habitants alentour étaient contents lorsqu’ils voyaient toute cette fumée qu’ils associaient à des récoltes abondantes. On voulait changer cette mentalité.
Comment tu as mis en place ce centre ? Tu as reçu des appuis ?
J’ai pris contact avec une française qui est partie avec moi au Nicaragua. On a lancé le projet au nom du diocèse, avec l’Union Européenne et des amitiés par-ci par-là. On a avancé avec des amis de Trento en Italie, qui nous ont aidés à avoir l’appui de la province. On a eu des financements comme ça. On a acheté des terrains, construit les bâtiments et trouvé des enseignants. On a aussi fait des partenariats avec des gens que j’avais rencontrés, par exemple l’Université Villanova à Philadelphie, ou encore Harvard (qui nous a envoyé des personnes en stage)… Aujourd’hui le centre est devenu une association indépendante. On forme des infirmières, des agriculteurs… on a eu des échanges avec Cuba, les Etats-Unis ou l’Espagne.
Quel est ton prochain grand chantier ?
Je vais arriver dans une nouvelle paroisse – a priori pour 2 ans – et je voudrais travailler les liens entre les personnes dans ces paroisses, pour mettre en place plus de décisions collectives. Ensuite je rentrerai chez moi car mon père est décédé et j’ai 9 frères. La famille commence à se déliter. Donc j’aimerais y passer 2 ou 3 ans.
Par ailleurs je m’intéresse beaucoup à ce qu’ont pu faire des prêtres au Brésil par le passé. Je suis né dans une paroisse où a exercé le « Contestador », un prêtre qui lutté pour des acquis sociaux et j’ai travaillé plus tard dans une paroisse où un prêtre avait lancé une petite révolution et avait même créé une petite république au sein de la ville de Belém. Il y a aussi un religieux qui a fondé des communautés un peu socialistes dans la région de Bahia. J’aimerais faire une relecture de tout ça et écrire quelque chose.
Des références qui t’ont aidé à te construire ?
Eduardo Galeano – les veines ouvertes de l’Amérique Latine. C’était le 1er livre qui m’a ouvert les yeux pour lire de l’autre côté de l’histoire, du côté des opprimés. Je suis né sous la dictature, j’ai fait la plupart de mes études sous la dictature (jusqu’en 1985). A l’école tous les contenus étaient l’histoire officielle, très normée, avec les timbres du gouvernement. J’ai trouvé ce bouquin un peu clandestin par l’association des étudiants (elle aussi interdite) en 1983 et ça m’a ouvert les yeux.
J’aime aussi citer Bartholomé de Las Casas, qui a dénoncé les pratiques des colons espagnols et défendu les amérindiens. Un jour, alors qu’il n’avait pas de pain pour célébrer la messe, les espagnols lui ont dit qu’il fallait faire faire du pain aux indiens. Lui il a dit qu’il ne pouvait pas faire du pain sacré avec du pain volé.
Mes autres références sont mes rencontres en Bolivie, au Pérou, au Chili, en Argentine, au Nicaragua, à Cuba ou à Salvador où j’ai pris beaucoup de contacts avec des sans terres et des mouvements paysans à la fin de mes études de théologie.
